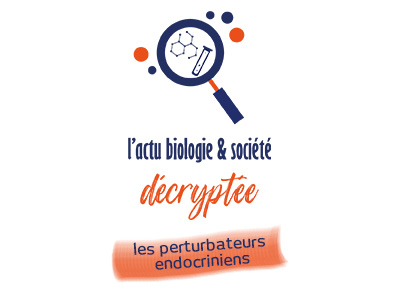
L’EBI décrypte : les perturbateurs endocriniens
Comprendre et agir – L’EBI s’engage avec Life ChemBee
Ils se cachent dans les plastiques, les cosmétiques, les produits d’entretien, les objets de décoration, les vêtements ou encore la poussière de nos logements. Invisibles mais omniprésents, leur impact sur la santé humaine et l’environnement est aujourd’hui reconnu. Mais que sont réellement ces substances, les perturbateurs endocriniens ? Pourquoi sont-elles si problématiques ? Et surtout, comment s’en protéger ?
L’École de Biologie Industrielle participe actuellement au projet européen Life ChemBee, qui propose de sensibiliser citoyens et salariés des collectivités aux perturbateurs endocriniens.
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Un perturbateur endocrinien est une substance chimique, naturelle ou artificielle, capable d’interférer avec le fonctionnement normal du système hormonal, aussi appelé système endocrinien. Ce système régule des fonctions biologiques essentielles telles que la croissance, la reproduction, le métabolisme, le développement cérébral… Une perturbation, même minime, peut entraîner des effets durables, parfois irréversibles. Les perturbateurs endocriniens dérèglent le fonctionnement hormonal des organismes vivants et ont ainsi des effets néfastes sur la santé humaine, et l’environnement.
Concrètement, un perturbateur endocrinien peut bloquer, imiter ou modifier le message transmis aux cellules par une hormone. Ces dérèglements peuvent survenir à très faibles doses, et surtout pendant des périodes sensibles comme la grossesse ou la petite enfance.
Contrairement à la toxicité aiguë, les perturbateurs endocriniens peuvent agir de manière différée. Leurs effets peuvent apparaître longtemps après l’exposition, voire se transmettre à la descendance. Ils défient également le modèle classique « la dose fait le poison » : certains effets apparaissent à faibles doses mais s’estompent à plus fortes concentrations. Cette spécificité complique l’évaluation des risques et la réglementation.
S’ajoute à cela l’effet cocktail : des substances apparemment inoffensives prises individuellement peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont combinées, même à très faibles doses. L’exposition simultanée à plusieurs perturbateurs endocriniens peut multiplier les effets sur la santé. Selon l’Inserm (2017), l’exposition simultanée à trois molécules ou plus peut multiplier les effets sur un organe par 10, voire 1 000. Pourtant, la réglementation actuelle se base encore sur l’analyse d’une molécule à la fois, ce qui sous-estime les risques liés à de multiples expositions. Toutefois, cette logique fonctionne aussi dans l’autre sens : en éliminant un seul perturbateur endocrinien, on peut réduire de manière significative l’impact global sur la santé.
Quels types de molécules sont concernées ? pour quels usages ?
Les perturbateurs endocriniens regroupent une grande diversité de molécules, d’origine naturelle ou synthétique, utilisées dans de nombreux domaines industriels et présents dans les produits de consommation courante. Parmi les familles de substances les plus étudiées :
- Les phtalates rendent les plastiques plus souples. On les retrouve dans des emballages alimentaires, des jouets, des rideaux de douche ou encore certains dispositifs médicaux.
- Le bisphénol A (BPA), anciennement utilisé dans les biberons et les contenants alimentaires en plastique rigide, est désormais remplacé dans certains usages par d’autres bisphénols (S, F…), dont l’innocuité reste à prouver.
- Les retardateurs de flamme bromés, intégrés à des textiles, mousses ou équipements électroniques pour limiter les risques d’incendie.
- Les parabènes, agents conservateurs présents dans les cosmétiques et produits d’hygiène.
- Les perfluorés (PFAS), appelés aussi « polluants éternels » en raison de leur persistance dans l’environnement et l’organisme, sont utilisés dans les revêtements antiadhésifs, les textiles imperméables et les mousses anti-incendie.
- Certains pesticides, comme le DDT (aujourd’hui interdit) ou le chlordécone, ont laissé des traces durables dans les sols et les chaînes alimentaires.
- Certaines molécules naturelles peuvent également interférer avec le système hormonal. Parmi les plus connues figurent les phytoestrogènes et certaines mycotoxines. Les phytoestrogènes sont naturellement présents dans certaines plantes, notamment les lignanes (graines de lin, céréales complètes) ou les isoflavones (soja, trèfle rouge). Les mycotoxines, quant à elles, sont des toxines produites par des champignons microscopiques contaminant les céréales, fruits secs, café ou épices. Ces composés n’échappent pas à la vigilance sanitaire : des seuils réglementaires encadrent leur présence dans les denrées alimentaires au sein de l’Union européenne.
Cette diversité rend leur repérage et leur réglementation complexes, car il ne s’agit pas d’un groupe homogène mais d’un ensemble de substances aux structures, usages et propriétés très variés. Leur impact sanitaire n’a été étudié que bien après leur mise sur le marché. Aujourd’hui, la difficulté réside dans l’équilibre entre utilité industrielle et protection de la santé publique.
Des molécules omniprésentes au quotidien
Les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans de nombreux objets et produits de la vie courante : contenants alimentaires, films plastiques, jouets, équipements médicaux, cosmétiques, produits ménagers, textiles traités, revêtements d’ameublement, ou encore produits phytosanitaires. Ainsi, présents dans des matériaux que nous touchons, respirons ou consommons, ces composés peuvent contaminer l’air intérieur (via les poussières domestiques ou les émanations de matériaux), s’infiltrer dans l’eau et les aliments (par migration ou épandage), ou encore être absorbés par la peau via les produits appliqués ou les objets manipulés. Leur diffusion invisible mais généralisée rend leur évaluation et leur régulation particulièrement complexes.
Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé ?
Les perturbateurs endocriniens peuvent provoquer des effets délétères sur le développement, la reproduction, le système immunitaire, le métabolisme et le système nerveux. L’exposition peut se produire à tous les âges de la vie, mais elle est particulièrement critique pendant les périodes sensibles comme la grossesse, l’enfance ou la puberté, car le corps traverse alors d’importants changements hormonaux. Certains perturbateurs endocriniens sont soupçonnés d’être impliqués dans l’augmentation des cas de cancers hormonodépendants (sein, prostate), de troubles de la fertilité, de maladies métaboliques (obésité, diabète), de troubles neurodéveloppementaux (autisme, TDAH), ou encore de pathologies thyroïdiennes. Il ne s’agit pas de céder à l’inquiétude, mais de mieux connaître les fenêtres de sensibilité pour adapter les gestes de prévention, particulièrement pour les femmes enceintes, les jeunes enfants et les adolescents. Ces connaissances sont aujourd’hui intégrées dans les recommandations des autorités sanitaires et les campagnes de sensibilisation à l’environnement santé.
Quelle réglementation ?
L’Union européenne dispose de l’une des législations les plus strictes au monde en matière de substances chimiques. Le règlement REACH impose aux industriels de prouver l’innocuité des substances mises sur le marché. Les perturbateurs endocriniens font également l’objet de réglementations sectorielles (cosmétiques, matériaux en contact avec les aliments, jouets…). Mais l’identification d’un perturbateur endocrinien reste complexe, et les évaluations peuvent prendre des années.
Comment se protéger ? Des gestes simples à adopter
Même si l’exposition aux perturbateurs endocriniens est diffuse, chacun peut réduire son exposition quotidienne. Ces habitudes simples, lorsqu’elles sont adoptées, peuvent avoir un impact mesurable sur la santé :
- Dans toutes les pièces : aérer son logement 10 à 15 minutes par jour pour évacuer les polluants de l’air intérieur, utiliser des produits ménagers simples (vinaigre, bicarbonate…) plutôt que des produits chimiques complexes, dépoussiérer régulièrement en particulier les textiles (canapés, rideaux, tapis),
- Dans la cuisine : réduire l’usage des contenants en plastique, éviter de chauffer les plastiques (micro-ondes, lave-vaisselle) et privilégier le verre, l’inox ou la céramique pour les contenants alimentaires, privilégier les produits alimentaires frais et bio pour réduire l’exposition aux pesticides,
- Dans la salle de bain : privilégier les produits solides, choisir des cosmétiques avec une liste d’ingrédients courte, sans parabènes, phénoxyéthanol, muscs synthétiques,
- Préférer les matériaux naturels pour les vêtements, meubles, jouets…,
- Privilégier la seconde main pour les vêtements, les laver avant de les porter quand ils sont neufs pour éliminer les traitements chimiques.
L’EBI engagée dans le projet européen Life ChemBee
Face à ces enjeux de santé publique, l’EBI s’implique activement dans Life ChemBee, projet européen visant à réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans les lieux de vie. Life ChemBee repose sur une approche à la fois scientifique, pédagogique et citoyenne. Son ambition : former un réseau d’ambassadeurs capables d’identifier les sources d’exposition, de réaliser des diagnostics à domicile ou au bureau, et de formuler des recommandations personnalisées. Ces actions permettent de sensibiliser tout en mesurant les changements de comportements avant et après.
À l’EBI, cette démarche s’est traduite en avril 2025 par la formation de 53 ambassadeurs (47 étudiants et 6 membres du personnel), grâce au soutien du Réseau Environnement Santé. Chaque ambassadeur s’est engagé à effectuer au moins deux diagnostics dans son entourage. Les ambassadeurs identifient des produits ou matériaux à risque, proposent des alternatives simples et adaptées, et contribuent ainsi à faire évoluer les pratiques du quotidien. Ce programme leur offre l’opportunité de se former à la communication en santé environnementale et d’agir de manière concrète. En tant que futurs ingénieurs amenés à évoluer dans les bioindustries, les étudiants de l’EBI ont un rôle clé à jouer pour devenir des acteurs du changement au sein des filières industrielles.
Un engagement pédagogique et sociétal
Mieux comprendre les perturbateurs endocriniens, c’est déjà mieux s’en protéger. Ce projet illustre la volonté de l’EBI de former des ingénieurs capables d’anticiper les défis de demain, de concilier innovation, éthique et développement durable. En participant à Life ChemBee, l’EBI renforce sa mission de diffusion des savoirs scientifiques au service de la santé et du bien commun.












